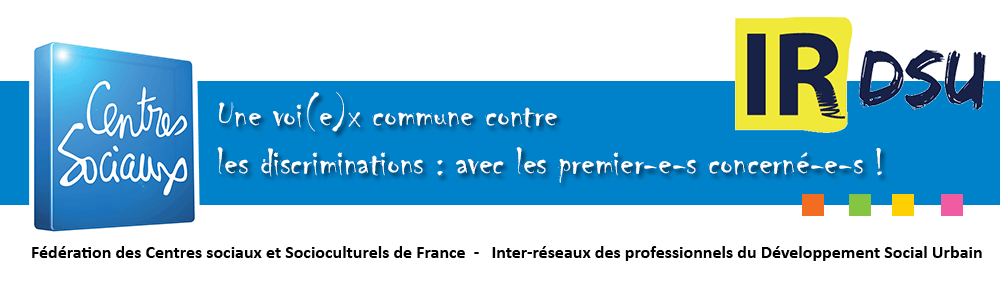La laïcité : un vecteur d’inclusion ou d’exclusion ?
Le décryptage d’Olivier NOEL*
« L’idée selon laquelle la laïcité est un principe à vivre, à faire vivre au quotidien me semble tout à fait pertinente et fidèle à l’esprit laïc. Mais l’idée selon laquelle, la laïcité serait une valeur[1], en tant que telle, me semble très problématique. Aujourd’hui nombre de philosophes qui s’invitent dans le débat public – tout en considérant que la laïcité n’est pas discutable – promeuvent une laïcité-interdit.
Si l’on part d’une définition communément admise que la laïcité est la fois une modalité de règlement des relations entre le religieux et le politique et une condition de l’émancipation et du vivre ensemble, alors il importe qu’elle reste un dispositif éminemment pratique qui requiert souci d’ouverture, de bon sens et de justice sociale. Ce qu’elle a été depuis le vote de la loi de 1905 séparant les églises et l’Etat jusqu’au vote de la loi du 15 mars 2004 interdisant le ports de signes ostensiblement religieux à l’école[2].
En paraphrasant, ce que Jean Jaurès disait à propos de la République, il me semble que l’on ne peut séparer la laïcité des idées de justice sociale sans lesquelles, elle ne serait qu’un mot. Autrement dit, ériger la laïcité en valeur, c’est prendre le risque de n’en faire qu’une laïcité rhétorique, formelle, dogmatique et de s’écarter d’une laïcité concrète qui favorise et facilite le vivre ensemble dans une société, de fait, diverse.
Le raisonnement que je développe est un raisonnement sociologique qui s’intéresse avant tout aux usages sociaux et actuels de la laïcité et à ses effets. Les défenseurs contemporains de la laïcité empruntent, depuis une dizaine d’années, deux voies distinctes. Les uns ont opté pour une logique d’extension de l’interdit juridique, une laïcité-interdit[3] (qui prend effet notamment dans le champ scolaire) alors que les autres restent attachés à un principe de laïcité-liberté[4], soucieux à la fois de préserver la liberté de conscience et de traiter de façon pratique, éducative, les situations qui font obstacle au principe de laïcité.
L’étude[5] que j’ai conduite de la mise en œuvre et les effets de la circulaire Chatel montre que la laïcité-interdit fait obstacle tour à tour au vivre ensemble, au principe de justice au sein des fratries (entre les enfants qui ont pu être accompagnés par leurs mères sorties scolaires et ceux qui ne le peuvent plus depuis la mise œuvre de la circulaire), au principe d’égalité entre les territoires (la circulaire est très inégalement mise en application), à l’émancipation des mères de familles qui portent le foulard, à la possibilité même d’organiser des sorties scolaires (nombre d’entre elles sont annulées faute de parents disponibles) ainsi qu’au principe de co-éducation entre parents, enseignants et élèves pourtant visé par la même circulaire.
En conséquence, il me semble que la laïcité-interdit (aujourd’hui assez largement instrumentalisée, notamment, mais pas seulement[6], par l’extrême-droite comme une forme plus ou moins consciente et affirmée d’islamophobie) mérite d’être questionnée afin qu’un véritable débat de fonds’engage non seulement sur les conceptions de la laïcité mais plus largement sur ses usages et ses effets afin que les professionnels du développement social urbain puissent s’en saisir concrètement pour fabriquer quotidiennement du lien social, du vivre ensemble autour de deux perspectives :
- Faire de la laïcité un problème public « par le bas », qui permette aux personnes concernées de partager le sujet et se l’approprier pour agir.
- Organiser des cadres collectifs au plus près des territoires pour construire de la pédagogie et des compromis.
* Olivier Noël est Maitre de conférences associé de sociologie politique, responsable du Master Professionnel Politique de la Ville et Développement Territorial à l’Université de Montpellier 3.
[1] Pierre Kahn, « La Laïcité est-elle une valeur ? », Spirale revue de recherche en sciences de l’éducation, N°39, 2007, pp. 29-37
[2] Françoise Lorcerie, « La loi sur le voile : une entreprise politique », Droit et Société, 2008, pp. 53-74
[3] Parmi lesquels on retrouve, entre autres, des philosophes comme Catherine Kinzler, Sarah Fleury, Abdenour Bidar, Henri Pena Ruiz.
[4] Parmi lesquels, on retrouve notamment Jean Baubérot, qui a été responsable de la chaire d’histoire et de sociologie de la laïcité à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.
[5] Olivier Noël, « Groupe de travail « Faire société commune dans une société diverse » : fabriquer autrement les politiques publiques », Migrations Société, n°155, pp. 101-114
[6] On observe en la matière plutôt un continuum idéologique qui traverse l’échiquier politique d’une partie de l’extrême-gauche à l’extrême-droite.