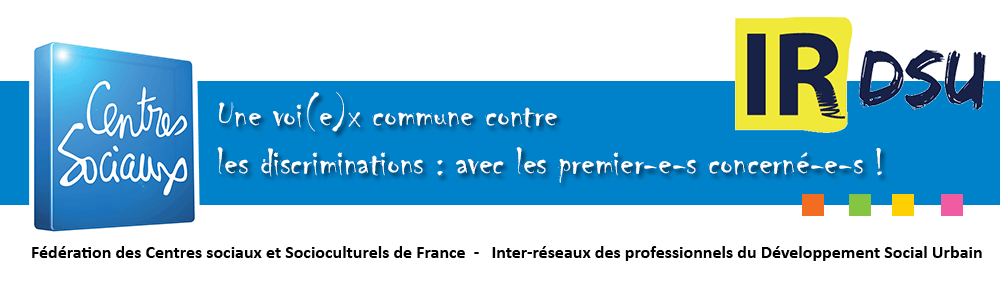La discrimination, une reconnaissance publique tardive…
Ce n’est qu’en 1998 avec le discours de Martine Aubry et la publication le même jour du rapport du Haut Conseil à l’Intégration consacré à la Lutte contre les discriminations : faire respecter le principe d’égalité que les discriminations vont être reconnues comme problème public.
Le problème c’est que la politique de lutte contre les discriminations, n’a pas été le produit de revendications explicites de citoyens mais plutôt une imposition par l’Europe à tous les Etats membres par les directives européennes de 2000 entre autres. Imposée ainsi par « le haut » ; ni les premiers concernés, ni les politiques et encore moins les chercheurs à cette période-là ne se sont appropriés ce problème. D’autant plus qu’en France, cette politique va entrer en contradiction avec le principe d’égalité sur lequel repose le modèle républicain français. Il y a donc une difficulté à admettre de la part du politique que l’idéal égalitaire est mis à mal. Il était d’autant plus facile par ailleurs de considérer l’absence d’égalité comme un manque d’intégration de la part des minorités ethniques que de remettre en cause le fonctionnement structurel de la société française. Avant 1998 par conséquent le terme de discrimination n’avait jamais été évoqué par les pouvoirs publics français.
En effet, la lutte contre les discriminations peine à s’imposer dans les pouvoirs publics français et est constamment disqualifiée et supplantée par d’autres actions, de lutte contre le racisme ou de promotion de la diversité, qui ont tendance finalement à contourner le vrai problème.
Cependant, l’appropriation difficile de cette question par le politique, les professionnels et les citoyens a eu pour conséquence une absence de changement dans les actions publiques et dans les pratiques des professionnels car finalement il n’y a pas eu d’interrogations sur « la nouveauté que représente la reconnaissance de la discrimination [et du coup] sur la compréhension des enjeux sociologiques que cristallise la lutte contre les discriminations […] » pour repenser la pratique et l’action (Fassin, 2002, p. 404). Il y a donc à penser et à faire, au niveau politique, social et professionnel. Il y a donc à penser et à faire, au niveau politique, social et professionnel, un changement de paradigme (c’est-à-dire une nouvelle manière de voir les choses) : l’idée n’est plus de se focaliser sur le problème d’un public à qui on assigne des difficultés supposée d’insertion ou d’intégration, qui s’est traduit par la mise en place de la politique d’insertion sociale et professionnelle en 1981 et la création des Missions Locales en 1982, MAIS de « repenser plus fondamentalement le problème public d’une société qui peine à mettre en œuvre concrètement son idéal égalitaire, et ce au-delà de la seule question raciale » (Olivier Noel, 2013).Ce changement de paradigme au niveau politique implique nécessairement un changement des pratiques politiques, institutionnelles et professionnelles.
Une voi(e)x communes contre les discriminations: avec les premier-e-s concerné-e-s!
Il est donc essentiel de s’approprier la lutte contre les discriminations. Comment ? En créant des espaces de paroles entre les professionnels, les habitants et aussi le politique afin de prendre conscience de ce qu’elles impliquent, de leurs impacts dans la trajectoire des victimes, de leurs ressentis pour parvenir ainsi, à travers l’échange d’expériences, à objectiver et à construire le problème public des discriminations avec le public concerné.
La construction collective du problème va permettre, à travers le dispositif des ateliers coopératifs et le croisement des savoirs professionnels, citoyens et universitaires de co-construire des pratiques professionnelles nouvelles intégrant la problématique des discriminations d’une part et d’outiller les 1ers concernés par les discriminations pour que leurs savoirs et leurs revendications s’inscrivent dans une démarche citoyenne d’autre part. En effet, le savoir des publics en situation de discriminations, basé sur leurs expériences n’a pas de reconnaissance a priori alors que les universitaires et les professionnels « disposent d’un savoir socialement reconnu, communicable, construit dans la durée. Ils connaissent les règles du jeu de par leur statut et leurs fonctions, ils ont le pouvoir d’agir, d’orienter ou de décider » (Charte ACSP). C’est pourquoi avant de renforcer le pouvoir d’agir il faut renforcer le pouvoir de comprendre des publics dans une démarche de co-formation : les premiers concernés forment par leur savoir et leur expérience quotidienne des discriminations les professionnels et ces derniers forment à leur tour les premiers concernés sur les recours juridiques entre autres.
Le rôle et la participation des citoyens sont fondamentaux dans ce projet qui se veut être une co-construction du problème des discriminations par le bas. Pour libérer la parole des habitants, il faut créer des espaces démocratiques d’échanges et d’écoutes au sein desquels la parole du public est reconnue comme légitime et participant à la construction collective d’un savoir.
Méthodologie
Comment faire pour garantir une expression libre ?
Pour permettre la libération de la parole et du savoir, il est essentiel de créer des espaces démocratiques où la parole de chacun est écoutée et considérée. Le rôle du professionnel est de créer ainsi les conditions nécessaires pour permettre aux publics de parler de leur vécu de la discrimination et de développer le pouvoir d’agir des premiers concernés.
Pour sa clarté et sa pertinence nous avons souhaité dans cette partie reprendre la charte du croisement des savoirs et des pratiques de l’ATD Quart Monde qui est intervenu, par ailleurs, lors du Congrès en 2013 pour parler des défis et des enjeux du pouvoir d’agir. Il nous a semblé utile de rappeler ces pré-requis pour favoriser le croisement des savoirs et des pratiques en les adaptant ici à la lutte contre les discriminations. Dans un second temps, nous évoquons la posture et le rôle des professionnels pour assurer les conditions nécessaires à l’expression libre des premiers concernés.
Pré-requis pour favoriser le croisement des savoirs et des pratiques
- Avoir conscience d’un changement nécessaire: les discriminations ne sont pas une fatalité.
- Considérer chacun comme détenteur des savoirs: sortir d’un rapport social tendu entre majoritaire/minoritaire dans lequel les majoritaires supposés détiendraient les savoirs et les solutions.
- Ne pas être seul : créer une communauté d’expériences pour consolider les savoirs et permettre d’aller plus loin.
- Se placer ensemble dans une position de recherche: tous les acteurs doivent être en position de co-chercheur, co-formateur pour problématiser la question des discriminations et chercher des pistes d’actions communes.
Rôles et postures des professionnels
Le rôle des professionnels : réunir les conditions de mise en œuvre du croisement des savoirs et des pratiques :
- Représenter les personnes en situation de discrimination: qui doivent être présentes tout au long du processus. personne ne doit parler à leur place, ni même des personnes qui disent connaître les discriminations.
- Établir un espace de confiance et de sécurité : assurance de la confidentialité des propos exprimés lors des ateliers et un cadre éthique qui implique l’écoute active, respect de la parole de l’autre, disponibilité à adopter une posture critique vis-à-vis de son propre savoir, tout savoir est toujours en construction.
- Garantir les conditions d’échange et de rigueur : créer la parité dans l’échange car nous ne sommes pas tous d’emblée dans une situation d’égalité. Le rôle des professionnels à l’égard des publics n’est pas de se substituer à eux en leur soufflant les mots qui ne sortent pas mais les amener à ce qu’ils consolident eux-mêmes leur propre savoir en croisant les autres expériences et récits pour généraliser et prendre ainsi du recul par rapport à son vécu. De la même manière que l’animateur doit faire attention au jargon et aux formulations trop abstraites du chercheur incompréhensibles pour des non initiés.
- Mettre en œuvre une méthodologie du croisement des savoirs et des pratiques : l’expérience de chacun, le rythme et la durée, la construction collective (transparence des procédures).
Des dispositifs et des méthodes à expérimenter…
Les outils utilisés peuvent être variés mais doivent tous permettre la liberté d’expression. Il nous semble que le jeu et le photolangage, testés et validés, sont des supports pédagogiques pertinents qui facilitent l’expression libre car ils permettent de prendre une certaine distance dans un premier temps avec son propre vécu, a priori plus difficile à exprimer car les discriminations restent encore un sujet tabou, sensible et intime. Le photolangage semble par conséquent être un outil pertinent qui permet :
- De favoriser l’expression libre
- De créer une communauté d’expériences
- De favoriser un processus de connaissance
- L’éveil d’une conscience politique à partir de ce savoir co-construit pour envisager les discriminations comme un problème de société.
- L’émergence d’autres actions/projet de lutte contre les discriminations et pour l’égalité : c’est un outil projectif.